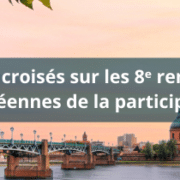Rencontres européennes de la participation : entre innovations prometteuses et défis persistants
Cette année, les acteurs et actrices de la participation se sont retrouvé·es à Strasbourg, capitale européenne et laboratoire de la démocratie, pour la 9ème édition des Rencontres de la participation.
Nous en retenons que, dans un contexte de fortes tensions démocratiques, il est absolument nécessaire de décentrer nos regards, d’assumer les conflits et de questionner nos façons de faire.
Comment faire évoluer nos pratiques pour construire une participation réellement inclusive et transformatrice ? Voici quelques pistes issues des ateliers auxquels nous avons assisté lors des Rencontres de la participation 2025.
Aller vers une participation inclusive et effective
La volonté d’une participation inclusive est unanime, au sein des Rencontres de la participation comme ailleurs. Mais force est de constater que ce sont encore et toujours les mêmes voix qui participent et qui s’expriment. Alors, comment donner une (réelle) place à celles et ceux qu’on n’entend moins, voire pas ?
Diversifier les portes d’entrée dans la participation
Tous les dispositifs participatifs sont confrontés à une difficulté majeure : mobiliser des publics aux profils divers. En particulier les plus jeunes, les personnes moins diplômées ou moins politisées. Les raisons sont multiples, et souvent entremêlées : freins matériels, défiance envers les institutions, sentiment d’illégitimité… S’il n’existe pas de solution miracle, nous avons néanmoins recueilli quelques exemples inspirants lors des Rencontres de la participation !
L’exemple de la FIDE en Allemagne montre que l’aller-vers, parfois par un simple porte-à-porte, peut porter ses fruits. 75% des participant·es à une démarche avaient commencé par refuser l’invitation issue d’un tirage au sort.
À Cherbourg ou à Tours, c’est en réinventant les lieux de participation (crèches, piscines, structures mobiles dans l’espace public) que l’on parvient à toucher de nouveaux publics. Et parfois, il suffit d’un outil inattendu pour engager la discussion. Comme une cocotte en papier créée pour échanger sur la qualité de l’air avec les habitant·es !
Ces expériences montrent qu’il est possible de favoriser l’implication des publics. Avec des moyens adaptés (humains comme financiers), du temps et des formats originaux et variés. Le recrutement des participant·es n’est cependant que la première étape. Assurer une participation effective, inclusive et durable reste un défi de fond, qui s’accompagne dans la durée.
Garantir l’expression de tous et toutes dans les dispositifs
La rencontre entre participant·es aux profils variés – personnes tirées au sort, membres d’associations, expert·es, personnes habituées des dispositifs – peut générer des tensions et renforcer des inégalités. En effet, les dispositifs participatifs, bien qu’ils soient conçus pour encourager la participation de tous et toutes, peuvent devenir des espaces où se reproduisent des formes de domination. C’est le cas lorsque certain·es participant·es monopolisent la parole ou imposent leurs cadres.
Comment éviter que les dynamiques de domination ne se rejouent dans les démarches participatives elles-mêmes ? Comment garantir que la diversité des profils se traduise par une véritable diversité des expressions ? Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour favoriser une cohabitation harmonieuse et garantir une expression véritablement démocratique de tous et toutes.
Par exemple, l’inversion des rôles, où les personnes déjà engagées prennent le temps d’écouter celles et ceux qui viennent d’horizons différents, peut permettre de rééquilibrer les échanges. Des techniques d’animation adaptées (temps de parole égaux ou bâtons de parole) aident également à donner une voix à chacun·e. Enfin, la formation des animateurs et animatrices à la gestion des conflits permet de maintenir un climat respectueux et inclusif.
À Strasbourg, une charte d’engagement a été conçue avec un cadre pensé avec les participant·es. Elle inclut des règles sur les attaques personnelles et les engagements fondamentaux à respecter dans le cadre de la démarche. Ce type d’outil garantit non seulement la qualité des échanges, mais aussi l’adhésion collective à des principes de respect et d’égalité. Essentiels pour la réussite d’une démarche participative véritablement inclusive.
Faire de l’égalité de genre un levier de participation
Les démarches participatives peuvent aussi reproduire des inégalités de genre : déséquilibres dans le temps de parole, interventions sexistes, sous-représentation des préoccupations féminines dans les discussions et dans les projets…
Pour prévenir les discriminations de genre, l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne a créé en 2024 un Guide de la participation en faveur de l’égalité de genre. Il propose des pistes de réflexion concrètes. Parmi lesquelles : veiller à l’attitude des animateurs et animatrices, attirer l’attention de tous et toutes sur le fait que les hommes prennent généralement la parole plus longtemps et plus souvent que les femmes, favoriser l’écrit, etc.
Des exemples concrets montrent que la participation peut (doit ?) permettre de lutter contre les inégalités de genre :
- La Ville de Nantes, qui a lancé en 2024 une concertation sur la lutte contre le sexisme dans les espaces publics. Au cours de laquelle des ateliers en non-mixité choisie ont été organisés.
- La Ville de Lyon, dont le budget sensible au genre* a permis de réaliser que les projets d’un budget participatif pouvaient reproduire les inégalités de genre. Par exemple, un projet de street-art dont l’œuvre peut représenter uniquement des hommes et être réalisé par des hommes.
Intégrer la question du genre dans les démarches participatives ne constitue pas une contrainte supplémentaire. Il s’agit d’une opportunité de garantir une participation véritablement équitable. Cela implique de repenser nos outils, nos formats et nos postures pour favoriser une participation et une représentation juste et inclusive de tous et toutes.
* Le budget sensible au genre est une méthode qui permet d’étudier les conséquences directes et indirectes des dépenses et recettes publiques sur les situations respectives des femmes et des hommes. Il s’agit d’étudier les budgets des politiques publiques et leur répartition pour déterminer s’ils accroissent ou réduisent les inégalités de genre.
Conflits et émotions : mieux les reconnaître pour mieux les accueillir
Et si ce que l’on redoute dans les démarches participatives – tensions, désaccords, émotions – en était en fait la matière première ? Dans un monde où les manipulations émotionnelles se multiplient, la participation a un rôle crucial à jouer. Celui de créer des espaces où ces émotions peuvent s’exprimer de manière authentique. Où les désaccords deviennent des leviers pour renforcer le débat démocratique et lutter contre la désinformation.
Faire de la place aux désaccords
Lors des Rencontres de la participation, nous avons été nombreux·ses à ressentir cette urgence : les démarches participatives ne peuvent plus se contenter d’être des espaces consensuels et policés. Refuser le conflit, c’est souvent refuser ce qui fait la richesse du débat démocratique. Accueillir les désaccords, c’est redonner du sens à la parole citoyenne. Dans un contexte de défiance généralisée, vouloir éviter le conflit à tout prix est contre-productif. Plusieurs ateliers l’ont rappelé avec force. La participation ne doit pas chercher le consensus “mou”. Elle doit, au contraire, créer les conditions d’une confrontation saine, dans un cadre sécurisé et respectueux.
À travers des exemples comme ceux de Grenoble, Poitiers ou Strasbourg, de nouvelles formes de démocratie d’interpellation émergent. Ici, la contestation est légitimée, structurée, outillée : droit à la médiation, ateliers d’interpellation, référendums d’initiative locale…
Ces dispositifs montrent qu’il est possible d’ancrer le désaccord dans un processus constructif. Ils ouvrent la voie à une participation qui ne se limite pas à « faire avec », mais qui reconnaît les contre-pouvoirs citoyens comme une richesse à intégrer pleinement dans la décision publique.
Accueillir les émotions plutôt que de lutter contre elles
Parler démocratie, c’est aussi parler de ce qui se joue dans les corps, les regards, les ressentis. Longtemps disqualifiées par un idéal de participation rationnelle, les émotions ont été considérées comme un risque pour la qualité du débat. Elles sont pourtant au cœur du lien démocratique et constituent de puissants leviers de compréhension et de transformation.
Ignorer les émotions, c’est pourtant entretenir une forme de domination qui oppose raison et émotion. Comme si seule la première était légitime dans l’espace public. C’est faire taire ceux qui ne maîtrisent pas les codes du débat argumenté. C’est refuser une part essentielle de ce qui fonde l’engagement politique.
Il ne s’agit pas de transformer la participation en théâtre émotionnel, mais de reconnaître leur rôle et de leur offrir un cadre d’expression. Cela suppose un espace sécurisé, une reconnaissance des ressentis – y compris chez les professionnel·les – et des outils adaptés. Tels que la communication non violente, marches sensibles, photo-langage, captation des verbatims…
L’expérience du jury citoyen “Strasbourg capitale de Noël” en est la preuve. Un cadre clair peut permettre un débat critique mais serein, où les émotions trouvent leur place de manière constructive.
Mieux prendre en compte les affects, c’est créer des espaces où l’on se sent écouté·e, légitime, et capable de construire du commun.
Lutter contre la manipulation des émotions grâce à la participation
L’écoute et la prise en compte des émotions est d’autant plus importante dans l’ère actuelle de la désinformation. De plus en plus, les citoyen·nes sont victimes d’opérations organisées cherchant à manipuler l’opinion et les émotions. Dans un contexte où la confiance envers les institutions s’érode, les campagnes de désinformation trouvent un terreau fertile pour prospérer et compromettre la qualité du débat démocratique.
Un des exemples les plus documentés, et présenté par Alliance4Europe lors des Rencontres de la participation, est l’opération Doppelgänger. Il s’agit d’une campagne de désinformation menée par des acteurs russes au sujet de la guerre en Ukraine. Des doubles numériques de sites de presse ont été créés pour diffuser des faux articles. L’objectif était d’influencer les électeurs et électrices à l’approche des élections européennes 2024.
Face à cette réalité, les dispositifs délibératifs doivent s’armer en intégrant une dimension critique et réflexive sur l’information. L’enjeu n’est pas d’immuniser les citoyen·nes contre toute émotion, mais de leur permettre de distinguer les réactions émotionnelles légitimes des manipulations orchestrées. Les dispositifs participatifs ont ici un rôle crucial à jouer : en créant des espaces où l’information peut être collectivement questionnée et où les doutes peuvent s’exprimer sans jugement. Dans ces conditions, la participation devient un rempart contre la désinformation.
Cette 9ème édition des Rencontres de la participation nous confirment une chose : il n’y a pas de recette miracle. Mais une conviction renforcée : pour répondre à la crise démocratique, il faut accepter la complexité, assumer les tensions, et surtout, faire confiance à l’intelligence collective des citoyen·nes, quel que soit leur profil et leur histoire. La démocratie participative ne se décrète pas. Elle se construit, pas à pas, dans l’expérimentation, l’écoute et l’engagement sincère.